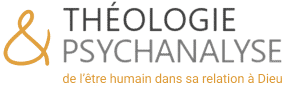« Méconnaissances chrétiennes de l’humain »
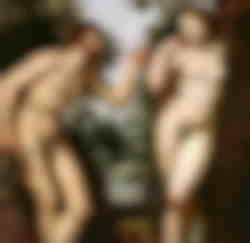 Dans cet article de 1982, toujours actuel, Antoine Vergote montre pourquoi et comment, dans le christianisme, « On n’a pas pleinement reconnu, compris et estimé l’humain ». Il expose en particulier en quoi l’ignorance des processus psychiques inconscients a conduit à un certain « surnaturalisme », attribuant directement à Dieu des phénomènes en grande partie conditionnés par le psychisme, ou en quoi la méconnaissance de la sexualité a conduit l’Église à tenir un discours peu crédible à son sujet.
Dans cet article de 1982, toujours actuel, Antoine Vergote montre pourquoi et comment, dans le christianisme, « On n’a pas pleinement reconnu, compris et estimé l’humain ». Il expose en particulier en quoi l’ignorance des processus psychiques inconscients a conduit à un certain « surnaturalisme », attribuant directement à Dieu des phénomènes en grande partie conditionnés par le psychisme, ou en quoi la méconnaissance de la sexualité a conduit l’Église à tenir un discours peu crédible à son sujet.
Extraits : « Les textes et les discours spirituels fourmillent d’expressions qui, n’étant pas fausses en soi, trahissent la tendance à surnaturaliser, c’est-à-dire à mettre au compte d’une initiative divine perceptible ce qui est aussi celle de l’homme. On appelle vocation par Dieu le projet de s’engager pour la vie religieuse. L’attraction pour la conversion chrétienne est un appel de Dieu. Les difficultés sur la voie choisie sont des épreuves que Dieu envoie. […] Pareil langage peut charger les épaules des hommes de lourds fardeaux. Ils sont nombreux les appelés ou les élus que la culpabilité de l’infidélité a tourmentés. » (p. 37) « La reconnaissance des processus proprement humains qui sont sous-jacents aux phénomènes mystiques, n’implique pas une réduction de ceux-ci à de l’humain pur. En effet, les dynamismes cachés que la psychologie met à jour ne produisent pas la présence de Dieu, mais ils en conditionnent les modalités : silence, visions, manifestation éclatante ou intuition de l’inhabitation durable. » (p. 39) « l’Église a senti que le plaisir charnel est une expérience si intense que de soi elle n’ouvre pas au désir de trouver le bonheur en Dieu mais qu’elle risque au contraire de l’absorber. Dieu et le plaisir ne sont pas dans une harmonie naturelle. La psychanalyse montre même que des raisons inconscientes font que l’homme les ressent comme en rivalité. […] Pour ceux qui savent comment la vie sexuelle peut élargir l’existence et confirmer l’amour et quelles sont les conséquences néfastes de sa perturbation, les lois de l’autorité ecclésiastique sont vraiment incompréhensibles. Actuellement, elles apparaissent comme la plus grave dénégation de l’humain. L’Église y perd non seulement son autorité en une matière qui est essentielle à la culture, sa méconnaissance de la réalité humaine rend suspecte son message religieux lui-même. » (p. 41)
« Le Père »
 Dans cet article de 2006, Antoine Vergote synthétise sa pensée au sujet de la figure paternelle au regard de la psychanalyse, de la psychologie de la religion et de la théologie. Il y situe « la paternité dans la structure de la famille, car c’est là qu’elle a son fondement et sa fonction ». Il y analyse ensuite « les dimensions d’une paternité qu’il détermine comme symbolique ». Il porte ensuite son attention « aux rapports conflictuels inhérents à la position du père ». Cet ensemble contribue « à élaborer le sens du terme père par lequel, à la suite de Jésus, les chrétiens s’adressent à Dieu ». Au terme de cette analyse, il se demande « si la tendance à effacer la différence entre les figures maternelle et paternelle n’est pas intimement cohérente avec la négation pratique ou raisonnée de la foi chrétienne en Dieu, ce Dieu qu’a révélé Jésus-Christ. L’idée de la paternité de Dieu s’affadit alors et devient “le divin” ; la foi se mue une confiance, souvent mêlée de sérénité sceptique, dans les promesses et rêves de bonheurs immédiates ».
Dans cet article de 2006, Antoine Vergote synthétise sa pensée au sujet de la figure paternelle au regard de la psychanalyse, de la psychologie de la religion et de la théologie. Il y situe « la paternité dans la structure de la famille, car c’est là qu’elle a son fondement et sa fonction ». Il y analyse ensuite « les dimensions d’une paternité qu’il détermine comme symbolique ». Il porte ensuite son attention « aux rapports conflictuels inhérents à la position du père ». Cet ensemble contribue « à élaborer le sens du terme père par lequel, à la suite de Jésus, les chrétiens s’adressent à Dieu ». Au terme de cette analyse, il se demande « si la tendance à effacer la différence entre les figures maternelle et paternelle n’est pas intimement cohérente avec la négation pratique ou raisonnée de la foi chrétienne en Dieu, ce Dieu qu’a révélé Jésus-Christ. L’idée de la paternité de Dieu s’affadit alors et devient “le divin” ; la foi se mue une confiance, souvent mêlée de sérénité sceptique, dans les promesses et rêves de bonheurs immédiates ».
Plan de l’article :
1. La paternité dans la structure familiale
2. Dimensions de la paternité symbolique
3. Difficultés à être père
3.1. Engagement requis
3.2. Les conflits dynamiques et leurs dangers
3.3. Jalousie
4. Dieu «notre Père»
« Pour une foi adulte »
 Dans cet article de 1968, au contenu toujours actuel, Antoine Vergote expose les conditions de possibilités psychiques d’une foi adulte. Il y évoque notamment la tension entre autonomie et obéissance, le danger d’infantilisme, le nécessaire dépassement de l’égocentrisme, l’accueil de la foi dans son objectivité, le refus d’une vision dévirilisante du christianisme. Il écrit, p. 434 : « Pour aucune donnée humaine, le danger d’infantilisme n’est aussi grand que pour la foi religieuse. Reproduisant, au niveau de l’attitude religieuse, des relations interpersonnelles familiales, elle risque d’échouer et de faire glisser, dans les rapports à Dieu, des attitudes filiales dérivées d’une enfance simplement humaine. La dogmatique chrétienne elle-même peut présenter l’illusion d’une relation vraiment religieuse alors que, dans la vérité vécue, elle n’est que le prolongement d’une attitude humaine. » ; p. 435 : « Enracinée dans la constellation familiale, l’attitude religieuse risque, plus que n’importe quel autre comportement, de conserver les traits infantiles de sa première émergence, d’autant plus que le contenu dogmatique lui-même s’y réfère comme à son lieu symbolique. » ; p. 437 : « Une image humaine s’interpose donc toujours entre Dieu et l’ homme qui n’est pas affectivement autonome. C’est la raison pour laquelle des vocations de crise deviennent souvent des crises de vocation. Au moment où cet homme se libère de ses besoins affectifs infantiles, il abandonne aussi facilement sa vie religieuse. Même des conversions n’échappent pas à cette loi. » ; p. 438 : « L’autonomie affective, caractéristique d’une psychologie adulte, paraît contraire au premier abord à l’idée psychologique de l’enfance et de l’obéissance de foi. A certains moments, elle s’y oppose aussi effectivement ; mais en vérité, elle en est la condition. » ; p. 442 : « Mais de toute façon le consentement intérieur à sa féminité et à sa maternité met la femme dans une attitude d’accueil qui la prédispose pour un accès contemplatif à l’absolu. L’homme, au contraire, par sa “maturation” psychologique même, est porté à résister à cette invite religieuse pour un abandon de lui-même. »
Dans cet article de 1968, au contenu toujours actuel, Antoine Vergote expose les conditions de possibilités psychiques d’une foi adulte. Il y évoque notamment la tension entre autonomie et obéissance, le danger d’infantilisme, le nécessaire dépassement de l’égocentrisme, l’accueil de la foi dans son objectivité, le refus d’une vision dévirilisante du christianisme. Il écrit, p. 434 : « Pour aucune donnée humaine, le danger d’infantilisme n’est aussi grand que pour la foi religieuse. Reproduisant, au niveau de l’attitude religieuse, des relations interpersonnelles familiales, elle risque d’échouer et de faire glisser, dans les rapports à Dieu, des attitudes filiales dérivées d’une enfance simplement humaine. La dogmatique chrétienne elle-même peut présenter l’illusion d’une relation vraiment religieuse alors que, dans la vérité vécue, elle n’est que le prolongement d’une attitude humaine. » ; p. 435 : « Enracinée dans la constellation familiale, l’attitude religieuse risque, plus que n’importe quel autre comportement, de conserver les traits infantiles de sa première émergence, d’autant plus que le contenu dogmatique lui-même s’y réfère comme à son lieu symbolique. » ; p. 437 : « Une image humaine s’interpose donc toujours entre Dieu et l’ homme qui n’est pas affectivement autonome. C’est la raison pour laquelle des vocations de crise deviennent souvent des crises de vocation. Au moment où cet homme se libère de ses besoins affectifs infantiles, il abandonne aussi facilement sa vie religieuse. Même des conversions n’échappent pas à cette loi. » ; p. 438 : « L’autonomie affective, caractéristique d’une psychologie adulte, paraît contraire au premier abord à l’idée psychologique de l’enfance et de l’obéissance de foi. A certains moments, elle s’y oppose aussi effectivement ; mais en vérité, elle en est la condition. » ; p. 442 : « Mais de toute façon le consentement intérieur à sa féminité et à sa maternité met la femme dans une attitude d’accueil qui la prédispose pour un accès contemplatif à l’absolu. L’homme, au contraire, par sa “maturation” psychologique même, est porté à résister à cette invite religieuse pour un abandon de lui-même. »
« What the Psychology of Religion Is and What It Is Not »
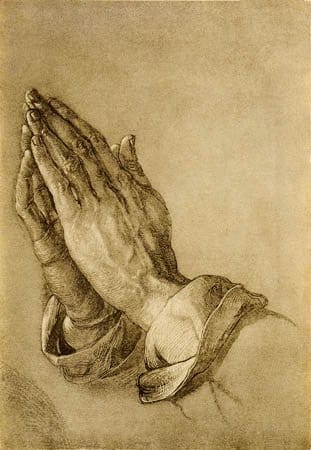 Dans cet article de 1993, publié dans The International Journal for the Psychology of Religion, Antoine Vergote expose et défend sa conception de la psychologie de la religion. Selon lui, elle « n’a ni la tâche ni la compétence de construire une théorie concernant l’essentiel de la religion ou son origine. Elle commence par observer le fait que certains sujets se réfèrent à une religion et que la religion est toujours trop complexe pour être interprétée comme relevant d’un système de pensée ou comme stratégie d’adaptation au monde. En psychologie de la religion, les hypothèses de travail purement intellectualistes ou fonctionnalistes ne sont jamais pertinentes. La psychologie étudie les désirs, émotions et représentations sous-jacents et largement préconscients entrant en jeu dans les rencontres avec des signifiants religieux et déterminant conditionnellement la façon dont chacun construit sa propre réponse. Les signifiants religieux — les symboles, les métaphores, les mots “Dieu” ou “créateur”, etc. — sont eux-mêmes multidimensionnels, et les désirs, émotions et représentations intérieurs du sujet sont surdéterminés. Ils ne sont pas dans une harmonie intérieure et pour cette raison se modifient en fonction des expériences vécues et, pour une personne religieuse, en fonction de différentes gratifications et déplaisirs religieux. Étudier les changements que représentent les expériences conflictuelles et leur résolution momentanée est la meilleur façon de saisir les représentations, émotions et structures sous-jacents qui sont (co)responsables des états observés de religion ou de non religion » (traduction libre de la conclusion de l’article)
Dans cet article de 1993, publié dans The International Journal for the Psychology of Religion, Antoine Vergote expose et défend sa conception de la psychologie de la religion. Selon lui, elle « n’a ni la tâche ni la compétence de construire une théorie concernant l’essentiel de la religion ou son origine. Elle commence par observer le fait que certains sujets se réfèrent à une religion et que la religion est toujours trop complexe pour être interprétée comme relevant d’un système de pensée ou comme stratégie d’adaptation au monde. En psychologie de la religion, les hypothèses de travail purement intellectualistes ou fonctionnalistes ne sont jamais pertinentes. La psychologie étudie les désirs, émotions et représentations sous-jacents et largement préconscients entrant en jeu dans les rencontres avec des signifiants religieux et déterminant conditionnellement la façon dont chacun construit sa propre réponse. Les signifiants religieux — les symboles, les métaphores, les mots “Dieu” ou “créateur”, etc. — sont eux-mêmes multidimensionnels, et les désirs, émotions et représentations intérieurs du sujet sont surdéterminés. Ils ne sont pas dans une harmonie intérieure et pour cette raison se modifient en fonction des expériences vécues et, pour une personne religieuse, en fonction de différentes gratifications et déplaisirs religieux. Étudier les changements que représentent les expériences conflictuelles et leur résolution momentanée est la meilleur façon de saisir les représentations, émotions et structures sous-jacents qui sont (co)responsables des états observés de religion ou de non religion » (traduction libre de la conclusion de l’article)
Deux ans plus tard, Vergote a précisé sa conception, en réponse à des commentaires d’autres psychologues de la religion
Télécharger cet article complémentaire »
« Concept of God and Parental Images »
 Dans cet article de 1969, écrit avec Alvaro Tamayo et d’autres, Antoine Vergote livre les résultats d’une recherche en psychologie de la religion portant sur la relation entre les figures parentales et Dieu, avec une attention spéciale à la différence entre les caractéristiques maternelles et paternelles. Dans tous les échantillons, l’image de Dieu est plus paternelle que maternelle. Une travail pionnier, toujours intéressant.
Dans cet article de 1969, écrit avec Alvaro Tamayo et d’autres, Antoine Vergote livre les résultats d’une recherche en psychologie de la religion portant sur la relation entre les figures parentales et Dieu, avec une attention spéciale à la différence entre les caractéristiques maternelles et paternelles. Dans tous les échantillons, l’image de Dieu est plus paternelle que maternelle. Une travail pionnier, toujours intéressant.
« Nature, culture et réalité psychique »
 Dans cet article de 1970, Vergote répond à la question de savoir « ce que la psychologie apporte à la question du rapport entre la nature et la culture » :
Dans cet article de 1970, Vergote répond à la question de savoir « ce que la psychologie apporte à la question du rapport entre la nature et la culture » :
I. Considérations épistémologiques sur le statut de la psychologie
1. La psychologie est partout et nulle part
2. L’inné et l’acquis
3. Une machine productrice ou douée d’esprit ?
4. Un rêve rousseauiste
II. Illustrations du psychique comme réalité mixte
1. La constitution de la personne
2. La pulsion
3. L’Œdipe ou l’interdit de l’inceste
Discussion
« La loi symbolique : négativité et instauration d’un ordre »

Dans cet article de 1988, Antoine Vergote traite successivement de :
I. Carences de la loi symbolique : la psychopathie et l’anomie
II. La loi symbolique qui fonde l’humanité : l’interdit de l’inceste et du parricide
III. La loi biblique comme formulation modèle de la loi symbolique
IV. En guise de conclusion : le concept et les lieux de la loi symbolique
« Image maternelle et image paternelle »
 Dans cette conférence publiée en 1967, Antoine Vergote expose en termes simples l’essentiel de l’approche psychanalytique des figures de la mère et du père. Il précise en particulier les différences entre l’approche freudienne et l’approche jungienne, et donne des éléments de compréhension des rapports entre l’image de Dieu et les figures maternelle et paternelle, et de la formation du désir religieux en lien avec ces deux figures.
Dans cette conférence publiée en 1967, Antoine Vergote expose en termes simples l’essentiel de l’approche psychanalytique des figures de la mère et du père. Il précise en particulier les différences entre l’approche freudienne et l’approche jungienne, et donne des éléments de compréhension des rapports entre l’image de Dieu et les figures maternelle et paternelle, et de la formation du désir religieux en lien avec ces deux figures.
« Réflexions psychologiques sur le devenir humain et chrétien du prêtre »
 Un article qui, malgré son ancienneté (1969), n’a pas beaucoup perdu de son actualité.
Un article qui, malgré son ancienneté (1969), n’a pas beaucoup perdu de son actualité.
« La fonction opérative du nom de Dieu »
 Dans cette étude très éclairante, publié en 1981, Antoine Vergote reconstitue les liens entre foi, religion, langage et foi originelle dans le sens du monde. Il s’appuie sur les données de l’anthropologie religieuse, de la linguistique, de la phénoménologie et de la psychanalyse, ainsi que sur son expérience et sa connaissance de la foi chrétienne.
Dans cette étude très éclairante, publié en 1981, Antoine Vergote reconstitue les liens entre foi, religion, langage et foi originelle dans le sens du monde. Il s’appuie sur les données de l’anthropologie religieuse, de la linguistique, de la phénoménologie et de la psychanalyse, ainsi que sur son expérience et sa connaissance de la foi chrétienne.