Thèmes du site
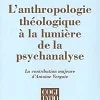
Théologie et psychanalyse
L’anthropologie théologique
à la lumière de la psychanalyse.
Le fruit d’une recherche approfondie

Antoine Vergote
Ressources sur le théologien, philosophe,
psychanalyste et psychologue de la religion Antoine Vergote
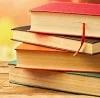
Textes
Ressources bibliographiques
sur théologie et psychanalyse
(références, recensions, textes complets)
Les dernières nouvelles sur théologie et psychanalyse
Les dernières nouvelles sur théologie et psychanalyse
Le pape François et la psychanalyse

À l’occasion de sa mort, voici un article sur le pape François et la psychanalyse. Dans son recueil d’entretiens avec Dominique Wolton, il s’était exprimé à ce sujet. Non seulement il la prend en compte dans son interprétation de la rigidité morale — en particulier celle de certains prêtres —, mais il évoque sa consultation, pendant six mois, d’une psychanalyste. En voici quelques extraits : (suite…)
Une lecture théologique et psychanalytique des tentations de Jésus

Rembrandt, Satan tentant le Christ (1635/1640)
En ce premier dimanche de Carême, voici une perle de Xavier Thévenot sur le texte d’Évangile du jour (Luc 4, 1-13) : dans « Conflits de conditions filiales. Les tentations de Jésus », il mobilise avec finesse les ressources de la psychanalyse pour montrer en quelques pages de réflexion théologique et spirituelle de lecture aisée en quoi Jésus échappe à la tentation de vivre sa relation filiale à Dieu selon un mode infantile qui ferait l’économie des médiations les plus structurantes (du temps, du travail, de la parole), et pousserait à la toute-puissance.
En voici deux extraits :
Vidéos sur foi et psychanalyse
Émission sur psychanalyse et religion (16 mn, Direct8, 2007) Avec la participation de Jean-Baptiste Lecuit, théologien, et de Patrick Chardeau et Linda Morisseau, psychanalystes
Émission “La foi prise au mot” sur foi et psychanalyse (52 mn, KTO, 2010) Avec la participation Macha Chmakoff, psychologue et psychanalyste, et David Larre, philosophe
Citations sur théologie et psychanalyse
Si l’on peut tirer de l’application de la méthode psychanalytique un argument nouveau contre la teneur en vérité de la religion, tant pis pour la religion, mais les défenseurs de la religion auront le même droit à se servir de la psychanalyse pour apprécier pleinement la signification affective de la doctrine religieuse. Et maintenant, pour aller plus avant dans la défense ; la religion a manifestement rendu de grands services à la culture humaine, elle a beaucoup contribué à dompter les pulsions asociales, mais pas suffisamment.
Il n’est pas nécessaire d’être croyant pour reconnaître dans le noyau originel de la foi chrétienne un paradigme de la conception authentiquement humaine de la figure paternelle. La paternité dans la relation humaine se manifeste dans un acte de parole relationnel et s’accomplit dans le processus même de reconnaissance de l’enfant, et comme la paternité est essentiellement un processus relationnel, l’autre, l’enfant, doit s’y impliquer. Dans la relation entre Jésus et son Dieu, le père communique sa divinité par un processus transformateur dans lequel Jésus s’implique lui-même. Dans l’ordre humain, s’agissant de la relation père-enfant, le père initie l’enfant à l’humanité que le père représente, médiatise et promeut par le processus transformateur du complexe d’Œdipe. Il y a donc indubitablement une analogie structurale entre la foi chrétienne et l’ordre humain
Dans la perspective de l’expérience, la rencontre de la psychanalyse mène à tout autre chose qu’à des confrontations d’idées aboutissant par exemple à une critique intellectuelle des idées de Freud sur la religion. Mais, comme expérience, elle peut conduire à ceci : « Je suis sur un divan. On m’a dit et répété que Dieu est amour. Je l’ai cru, et en parlant de papa et maman, tout à coup je découvre que la formule : “Dieu est amour” voulait dire que ma mère ne voulait pas me laisser vivre. » C’est tout à fait autre chose, une découverte imparable. Je suis délogé de ma position de croyant, de discoureur, de ma position de controversiste. Je m’enfonce dans le tréfonds de l’inconscient



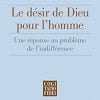
 Si l’on peut tirer de l’application de la méthode psychanalytique un argument nouveau contre la teneur en vérité de la religion, tant pis pour la religion, mais les défenseurs de la religion auront le même droit à se servir de la psychanalyse pour apprécier pleinement la signification affective de la doctrine religieuse. Et maintenant, pour aller plus avant dans la défense ; la religion a manifestement rendu de grands services à la culture humaine, elle a beaucoup contribué à dompter les pulsions asociales, mais pas suffisamment.
Si l’on peut tirer de l’application de la méthode psychanalytique un argument nouveau contre la teneur en vérité de la religion, tant pis pour la religion, mais les défenseurs de la religion auront le même droit à se servir de la psychanalyse pour apprécier pleinement la signification affective de la doctrine religieuse. Et maintenant, pour aller plus avant dans la défense ; la religion a manifestement rendu de grands services à la culture humaine, elle a beaucoup contribué à dompter les pulsions asociales, mais pas suffisamment. Il n’est pas nécessaire d’être croyant pour reconnaître dans le noyau originel de la foi chrétienne un paradigme de la conception authentiquement humaine de la figure paternelle. La paternité dans la relation humaine se manifeste dans un acte de parole relationnel et s’accomplit dans le processus même de reconnaissance de l’enfant, et comme la paternité est essentiellement un processus relationnel, l’autre, l’enfant, doit s’y impliquer. Dans la relation entre Jésus et son Dieu, le père communique sa divinité par un processus transformateur dans lequel Jésus s’implique lui-même. Dans l’ordre humain, s’agissant de la relation père-enfant, le père initie l’enfant à l’humanité que le père représente, médiatise et promeut par le processus transformateur du complexe d’Œdipe. Il y a donc indubitablement une analogie structurale entre la foi chrétienne et l’ordre humain
Il n’est pas nécessaire d’être croyant pour reconnaître dans le noyau originel de la foi chrétienne un paradigme de la conception authentiquement humaine de la figure paternelle. La paternité dans la relation humaine se manifeste dans un acte de parole relationnel et s’accomplit dans le processus même de reconnaissance de l’enfant, et comme la paternité est essentiellement un processus relationnel, l’autre, l’enfant, doit s’y impliquer. Dans la relation entre Jésus et son Dieu, le père communique sa divinité par un processus transformateur dans lequel Jésus s’implique lui-même. Dans l’ordre humain, s’agissant de la relation père-enfant, le père initie l’enfant à l’humanité que le père représente, médiatise et promeut par le processus transformateur du complexe d’Œdipe. Il y a donc indubitablement une analogie structurale entre la foi chrétienne et l’ordre humain Dans la perspective de l’expérience, la rencontre de la psychanalyse mène à tout autre chose qu’à des confrontations d’idées aboutissant par exemple à une critique intellectuelle des idées de Freud sur la religion. Mais, comme expérience, elle peut conduire à ceci : « Je suis sur un divan. On m’a dit et répété que Dieu est amour. Je l’ai cru, et en parlant de papa et maman, tout à coup je découvre que la formule : “Dieu est amour” voulait dire que ma mère ne voulait pas me laisser vivre. » C’est tout à fait autre chose, une découverte imparable. Je suis délogé de ma position de croyant, de discoureur, de ma position de controversiste. Je m’enfonce dans le tréfonds de l’inconscient
Dans la perspective de l’expérience, la rencontre de la psychanalyse mène à tout autre chose qu’à des confrontations d’idées aboutissant par exemple à une critique intellectuelle des idées de Freud sur la religion. Mais, comme expérience, elle peut conduire à ceci : « Je suis sur un divan. On m’a dit et répété que Dieu est amour. Je l’ai cru, et en parlant de papa et maman, tout à coup je découvre que la formule : “Dieu est amour” voulait dire que ma mère ne voulait pas me laisser vivre. » C’est tout à fait autre chose, une découverte imparable. Je suis délogé de ma position de croyant, de discoureur, de ma position de controversiste. Je m’enfonce dans le tréfonds de l’inconscient