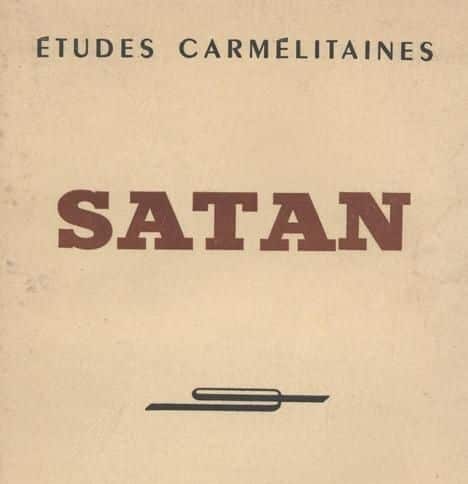 Pionnière de l’ouverture de la pensée religieuse à la psychanalyse, la revue Études carmélitaines fut placée, à partir de 1930, sous la direction du carme Bruno de Jésus-Marie. L’expérience religieuse et mystique y fut notamment abordée par les contributions de psychiatres, psychologues et psychanalystes, tels Pierre Jeannet, Louis Beirnaert ou Françoise Dolto. C’est de manière résolument critique qu’y sont évalués les stigmates de Madeleine Lebouc, les apparitions de Beauraing ou les visions de Thérèse Neumann. À partir de 1935, Bruno de Jésus-Marie organisa des Journées de psychologie religieuse, auxquelles participèrent des psychologues de la religion de divers pays européens, et dont les actes furent publiés dans la revue : Douleur et stigmatisation (1936) ; Illuminations et sécheresses (1937) ; Nuit mystique (1938), etc. Le numéro sur Satan (1948, 666 [!] pages) fut particulièrement remarqué.
Pionnière de l’ouverture de la pensée religieuse à la psychanalyse, la revue Études carmélitaines fut placée, à partir de 1930, sous la direction du carme Bruno de Jésus-Marie. L’expérience religieuse et mystique y fut notamment abordée par les contributions de psychiatres, psychologues et psychanalystes, tels Pierre Jeannet, Louis Beirnaert ou Françoise Dolto. C’est de manière résolument critique qu’y sont évalués les stigmates de Madeleine Lebouc, les apparitions de Beauraing ou les visions de Thérèse Neumann. À partir de 1935, Bruno de Jésus-Marie organisa des Journées de psychologie religieuse, auxquelles participèrent des psychologues de la religion de divers pays européens, et dont les actes furent publiés dans la revue : Douleur et stigmatisation (1936) ; Illuminations et sécheresses (1937) ; Nuit mystique (1938), etc. Le numéro sur Satan (1948, 666 [!] pages) fut particulièrement remarqué.
On trouvera ci-dessous :
- Des indications historiques d’Étienne Fouilloux et Agnès Desmazières sur les Études carmélitaines
- Certains articles de la revue
- Les tables de tous les volumes parus
- Une notice biographique sur Bruno de Jésus-Marie
- Un bref historique de la nouvelle série des Études carmélitaines
- Un bref historique des Journées de psychologie religieuse
- Les 25 ans de la revue
- Un bref historique de la fin de la revue
Indications historiques sur les Études carmélitaines
Extraits d’un article disponible en ligne Agnès Desmazières, « L’expérience mystique de saint Jean de la Croix à l’aune des sciences humaines », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2016/2 (N° 130), p. 59-75 :
Le Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique de Baruzi, le Saint Jean de la Croix de Bruno de Jésus-Marie et les Journées de psychologie religieuse de 1937 et 1938, consacrées à l’expérience de la nuit mystique, représentent trois étapes majeures d’une redéfinition des rapports entre vérité scientifique et vérité religieuse dans le contexte de l’émergence des sciences humaines. Ce parcours révèle l’interpénétration croissante qui se fait jour, dans le domaine des études mystiques, entre science séculière et pensée religieuse (p. 61) […] Le dialogue entre théologie spirituelle et psychologie devient dès lors la marque de fabrique de la revue des carmes français. Cette rencontre est placée sous les auspices de Jean de la Croix en qui Bruno de Jésus-Marie voit un « clinicien » hors pair dont « jamais psychiatre sérieux ne critiquera » l’enseignement. Alors que la rencontre entre la psychologie spéculative de la Sorbonne et la mystique carmélitaine apparaissait vouée à l’échec, une ouverture se fait jour sur un nouveau terrain, celui de la psychologie pathologique. Les Études carmélitaines, soucieuses de purifier la mystique de ses excroissances extraordinaires douteuses, veillent à un meilleur discernement entre vraie et fausse mystique et appellent en renfort la psychologie et la psychiatrie. L’examen par Bruno de Jésus-Marie, à partir de sources inédites, du cas de Madeleine Lebouc, rendu célèbre par Pierre Janet, assoit la réputation scientifique de la revue. L’approche résolument critique de cette dernière à l’égard des phénomènes mystiques, qui s’exprime en particulier dans les enquêtes menées sur la stigmatisée bavaroise Thérèse Neumann ou sur les apparitions mariales de Beauraing en Belgique, suscite l’attention de nombre de scientifiques européens. L’entreprise trouve véritablement sa consécration avec le lancement, en 1935, des Journées de psychologie religieuse, qui réunissent chaque année au couvent des carmes d’Avon des philosophes, théologiens, psychologues et psychiatres, préoccupés par une étude interdisciplinaire de la mystique (p. 70)
Voir aussi Agnès Desmazières, L’inconscient au paradis, Comment les catholiques ont reçu la psychanalyse, Payot, 2011, p. 64-66 et 91-92.
Sur la renaissance des Études carmélitaines, voir Étienne Fouilloux, « Bruno de Jésus-Marie et les Études carmélitaines (1930-1939) », in Bernard Hours (dir.), Carmes et carmélites en France du 17e siècle à nos jours : actes du colloque de Lyon (25-26 septembre 1997), Éd. du Cerf, 2001, p. 319-332 :
Grâce à ce qu’il faut bien appeler le génie (parfois encombrant) de son directeur, elle opère d’emblée une percée dans les milieux intellectuels : succès de curiosité dû à son esprit batailleur d’abord ; mais plus profondément et plus durablement, succès dû à la réussite du mariage inédit entre l’approche scientifique et l’approche religieuse des phénomènes spirituels, ascétiques et mystiques (p. 332)
Articles de la revue disponibles en lignes
Sur ce site
le numéro des Études carmélitaines consacré au P. Bruno de Jésus-Marie
De Louis BEIRNAERT :
- « La signification du symbolisme conjugal dans la vie mystique », Études carmélitaines (1952/1) 380-389
- « Note sur les attaches psychologiques du symbolisme du cœur chez sainte Marguerite-Marie », Études carmélitaines (1950/2) 228-233
- « Pratique de la direction spirituelle et psychanalyse », Études carmélitaines (1951) 316-330
- « Sens chrétien du péché et fausse culpabilité », Études carmélitaines (1949/2) 31-41
De Françoise DOLTO :
- « Dépendance de l’enfant vis-à-vis de ses parents », Études carmélitaines, Structures et liberté (1958/1)
- « Acquisition de l’autonomie », Études carmélitaines, Limites de l’humain (1953) 137-160
- « Continence et développement de la personnalité », Études carmélitaines, Mystique et continence (1952/1) 209-219
- « Le cœur, expression symbolique de la vie affective », Études carmélitaines, Le cœur (1950/2)
- « Comment on crée chez l’enfant une fausse culpabilité », Études carmélitaines (1949) 43-55
- « Le diable chez l’enfant », Études carmélitaines, Satan, (1948/1)
Sur d’autres sites
- Le numéro sur Satan (1948), en particulier l’article de François Dolto, « Le diable chez l’enfant »
- Jean LHERMITTE, « Marie-Thérèse Noblet considérée du point de vue neurologique », Études carmélitaines, mystiques et missionnaires, « Nature et Grâce. Sainteté et Folie », 23/2 (1938), p. 201-209.
Tables des volumes parus
Le P. Bruno de Jésus-Marie
[par Dominique Poirot, ocd, 1932-2014] Le Père Bruno de Jésus-Marie, O.C.D. est nommé Directeur des Études carmélitaines le 16 mai 1930 ; il le demeure jusqu’à sa mort à Paris, le 16 octobre 1962. Né Jacques Froissart à Bourbourg dans les Flandres françaises, le 25 juillet 1892, après ses Études secondaires la lecture de L’Histoire d’une âme de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus l’invite à découvrir les Évangiles. Après un premier essai de vie religieuse au Noviciat des Carmes déchaux en décembre 1916, essai non-concluant, il part à Rome faire ses Études ecclésiastiques à l’Angelicum. Le 14 septembre 1920, il entre de nouveau au Noviciat des Carmes déchaux, pour y rester. Ordonné prêtre en 1924, il est envoyé à la Résidence de la rue Scheffer à Paris qui devient alors, par son rayonnement personnel et celui l’Ordre, le centre du renouveau de vie intellectuelle et spirituelle que nous connaissons.
Consulter la totalité du numéro des Études carmélitaines consacré au P. Bruno de Jésus-Marie »
DANS CE NUMÉRO :
GÉRARD DE LA TRINITÉ, « Notice biographique », p. 7-18
LUCIEN-MARIE DE S. JOSEPH, « Portrait », p. 19-26
M. D. CHENU, « Les Études Carmélitaines », p. 27-29
René HUYGHE, « Science et mystique », p. 31-34
A. PLÉ, « La vie spirituelle et les Études Carmélitaines », p. 35-36 :
[Extrait] Le P. Bruno de Jésus-Marie, O. C. D., est décédé le 16 octobre 1962.
Le Supplément de la Vie Spirituelle et son directeur ne peuvent taire leur peine et leur reconnaissance. Je n’ai jamais oublié son accueil quand, en 1946, j’avais été lui rendre visite, rue Scheffer, pour lui parler du Supplément, qui n’était alors qu’un projet. Après un premier mouvement — combien justifié — de réticence et d’inquiétudes, il me laissa m’expliquer tout au long et je ne sortis de chez lui qu’après qu’ont été précisés entre nous le domaine de chacun et les lignes de convergence de nos efforts. Je savais aussi, en le quittant, que j’avais trouvé un ami extraordinaire, riche de sensibilité et de profondeur spirituelle, d’une perspicacité, d’un courage, d’une prudence, d’une loyauté, sans lesquels il n’aurait pas pu, d’ailleurs, être ce qu’il était : l’heureux pionnier dans une ligne de recherches des plus périlleuses et où le Supplément allait s’engager à la suite et en fraternelle complémentarité des « Études Carmélitaines » (p. 35)
L. BEIRNAERT, « Le Père Bruno et la psychologie religieuse », p. 37-42 :
[Extrait] Le Père Bruno reprend à son compte la distinction de Dalbiez entre méthode psychanalytique et doctrine freudienne, et, rejetant la doctrine en ce qu’elle a de réducteur, il demande au psychanalyste d’appliquer sa méthode pour rendre raison d’aspects particuliers, excessifs, ou pathologiques, de la vie religieuse. Ici encore, une place est reconnue, mais des limites sont tracées : les conflits inconscients n’expliquent pas tout, et surtout il ne saurait être question pour la psychanalyse de réduire l’inquiétude humaine en ce qu’elle a de fondamental (p. 39).
BRUNO DE JÉSUS-MARIE, « Le mouvement des Études Carmélitaines, les congrès d’Avon et les encouragements de l’Église », p. 43-48
« Bibliographie du R. P. Bruno de Jésus-Marie », p. 49-53
La nouvelle série des Études carmélitaines
[par Dominique Poirot, ocd, 1932-2014] Le Père Bruno inaugure ainsi une nouvelle série des Études carmélitaines, chez Desclée de Brouwer, qui couvrira la période de 1931 à 1962, avec une interruption de 1940 à 1944, années de la guerre. Ces Études comportent quarante-neuf volumes, ordinairement deux volumes par année. Cette nouvelle série conserve toute sa renommée.
Les premiers volumes, de 1931 à 1936, gardent le seul titre d’Études carmélitaines, mystiques et missionnaires. Après quelques articles, ils comportent des recensions de livres ou de revues et l’apport de textes anciens ; parfois d’autres rubriques traitent de questions religieuses contemporaines.
Sauf le volume de 1935/1 a pour titre : La vie carmélitaine, plus significatif de l’esprit de la nouvelle Province de Paris, créée en 1932. Le Troisième centenaire de cette Province donne l’occasion d’une première rencontre de témoins, les 25-26 avril 1935 au Couvent d’Avon. Progressivement, la Revue prend son envol avec l’organisation de Journées de Psychologie religieuse. Le patrimoine de l’Ordre, sainte Thérèse de Jésus (d’Avila) et saint Jean de la Croix en premiers, est soigneusement gardé et exploré.
Les Journées de psychologie religieuse
[par Dominique Poirot, ocd, 1932-2014] Avec l’émergence des sciences nouvelles et surtout celle de la psychanalyse, les questions du temps ainsi que l’urgence missionnaire sont prises en compte, d’où le choix des Thèmes et des Titres, à partir de 1936/2. Le Père Bruno présente alors les articles dans un Argument explicatif qui donne la table des articles.
S.S. Pie XI fait adresser par l’intermédiaire du Cardinal Pacelli au Père Bruno une lettre très encourageante le 3 janvier 1937 dans laquelle il affirme : « Ce fut en effet une initiative des plus judicieuse que d’élargir comme vous le fîtes il y a six ans le champs d’action de ce périodique, en étendant son objet à tout le domaine de la psychologie religieuse ; et d’ailleurs l’accueil même qui a été fait aux Études carmélitaines sous leur nouvelle forme suffit à montrer combien cette transformation était opportune et combien elle a été appréciée de tous ceux qui s’intéressent à la vie profonde de Dieu dans l’âme chrétienne.
La haute compétence des rédacteurs que vous avez appelés à y collaborer, le sérieux et l’originalité des questions qui y sont traitées, la sûreté de la documentation, sont autant de facteurs qui en rehaussent singulièrement le prix, facteurs auxquels les qualités extérieures de présentation ne font qu’apporter le plus heureux complément. » (Études carmélitaines, 1964, p. 44)
Les rencontres rassemblent des personnalités de diverses compétences pour permettre une confrontation entre l’expérience spirituelle et les sciences nouvelles, voire une vérification de cette expérience…comme cela avait déjà eu lieu dans le passé, ainsi que la rappelle Agostino Gemelli, O. F. M. dans le message qui se trouve en 1949/2 : « IIe Congrès international de Psychologie, tenu à Genève en 1909 ». Réunions, Congrès, Journées de Psychologie religieuse regroupent les spécialistes les plus compétents, éminents ou qui le deviendront par la suite. Les titres de ces personnalités sont quelquefois signalés.
Ces rencontres se déroulent au couvent d’Avon, puis avec l’ouverture de ces nouveaux lieux, à Bordigné dans la Sarthe et finalement au château de Séchelles dans l’Oise ; elles précèdent les parutions. Rappelons les dates de huit rencontres significatives et productrices, à l’origine de différents volumes :
– Première rencontre : Troisième centenaire de la Province de Paris, les 25-26 avril 1935, comme il est écrit plus haut ; à l’occasion de ce centenaire
est publié La vie carmélitaine, 1935/1.
– Deuxième rencontre : Journées de Psychologie religieuse, les 17-18, 19 avril 1936 : Douleur et stigmatisation, 1936/2.
– Troisième rencontre : Journées de Psychologie religieuse, les 21, 22 et 23 juillet 1937 : Illuminations et sécheresses, 1937/2.
– Quatrième rencontre : Congrès international de Psychologie religieuse, les 21-22 et 23 septembre 1938 : Nuit mystique, 1938/2 et Le risque chrétien, 1939/1.
– Cinquième rencontre : Cinquième Congrès International de Psychologie religieuse tenu à Avon les 18-19-20 septembre 1948 : Trouble et lumière, 1949/2.
– Sixième rencontre : Rencontre d’Avon du 19 septembre 1948, deuxième journée du Congrès international, « un groupe restreint et choisi de
théologiens et de spécialistes » étudie le thème : Technique et contemplation 1949/3.
– Septième rencontre : Congrès tenu à Avon du 27 au 30 septembre 1950. Ouvrage hors série de la trente et unième année des Études carmélitaines, Mystique et continence, 1952/1, reprend les travaux scientifiques du VIIe congrès international d’Avon.
– Huitième et dernière rencontre : Structures et liberté, 1958/1, fête le 25e anniversaire des Études carmélitaines à Séchelles (Oise).
Photos du hors-texte en face de la page 13 de la brochure XXVe anniversaire des Études carmélitaines, 1956 :


Les 25 ans de la revue
En 1956, à l’occasion des 25 ans de la revue, une brochure est imprimée, qui contient :
- Un historique de la revue et du rôle de son directeur, le P. Bruno de Jésus-Marie, par les éditions Desclée de Brouwer (p. 3-6)
- Une lettre du préposé général des carmes déchaux, ANASTASE DU TRÈS-SAINT ROSAIRE, au P. Bruno (p. 7-8)
- Le discours de Germain BAZIN pendant le congrès des 25 ans des Études carmélitaines (p. 9-15)
- Le discours d’Étienne DE GREEFF pendant le congrès des 25 ans des Études carmélitaines (p. 15-17)
- Le discours de René LAFORGUE pendant le congrès des 25 ans des Études carmélitaines (p. 18)
- Le discours du P. MARIE-EUGÈNE DE L’ENFANT-JÉSUS à l’occasion des 25 ans des Études carmélitaines (p. 18-20)
Extrait du discours du (Bienheureux) P. MARIE-EUGÈNE DE L’ENFANT-JÉSUS (p. 19-20) : « Je ne veux pas préjuger du jugement de l’histoire, mais il me semble, cher Père Bruno, que déjà vous êtes inscrit parmi les grands travailleurs spirituels, parmi les grands religieux de notre siècle »
La fin de la revue
[par Dominique Poirot, ocd, 1932-2014] Les titres qui encadrent le vide de la guerre 1939–1945 sont significatifs ! Ainsi avant la guerre : Les hommes sont-ils égaux ? 1939/2.
Comment ne pas penser au National-socialisme et à la montée du nazisme ? Après la guerre, le premier titre sera : Amour et violence 1946.
A partir de 1948, avec Satan, la plupart des volumes ont un Liminaire, rédigé par le Père Bruno.
À partir de 1946, dix-sept volumes sont édités dans la collection ; ce sont des livres écrits par un unique auteur.
Les autres volumes sont le fruit de dialogue du Père Bruno avec des personnalités de diverses disciplines pour parvenir à un thème commun.
Certaines questions sont reprises dans plusieurs volumes.
Un cinquantième volume de 54 pages est composé par Gérard de la Trinité : Le Père Bruno de Jésus-Marie, 1964. Il relate la vie et l’œuvre
du Père Bruno.
Photo de Bruno de Jésus-Marie publiée dans la brochure XXVe anniversaire des Études carmélitaines, 1956, dans le hors-texte en face de la page 12 :

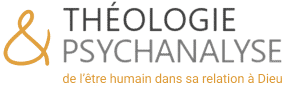
 [par
[par  [par
[par  [par
[par  Ces rencontres se déroulent au couvent d’Avon, puis avec l’ouverture de ces nouveaux lieux, à Bordigné dans la Sarthe et finalement au château de Séchelles dans l’Oise ; elles précèdent les parutions. Rappelons les dates de huit rencontres significatives et productrices, à l’origine de différents volumes :
Ces rencontres se déroulent au couvent d’Avon, puis avec l’ouverture de ces nouveaux lieux, à Bordigné dans la Sarthe et finalement au château de Séchelles dans l’Oise ; elles précèdent les parutions. Rappelons les dates de huit rencontres significatives et productrices, à l’origine de différents volumes :